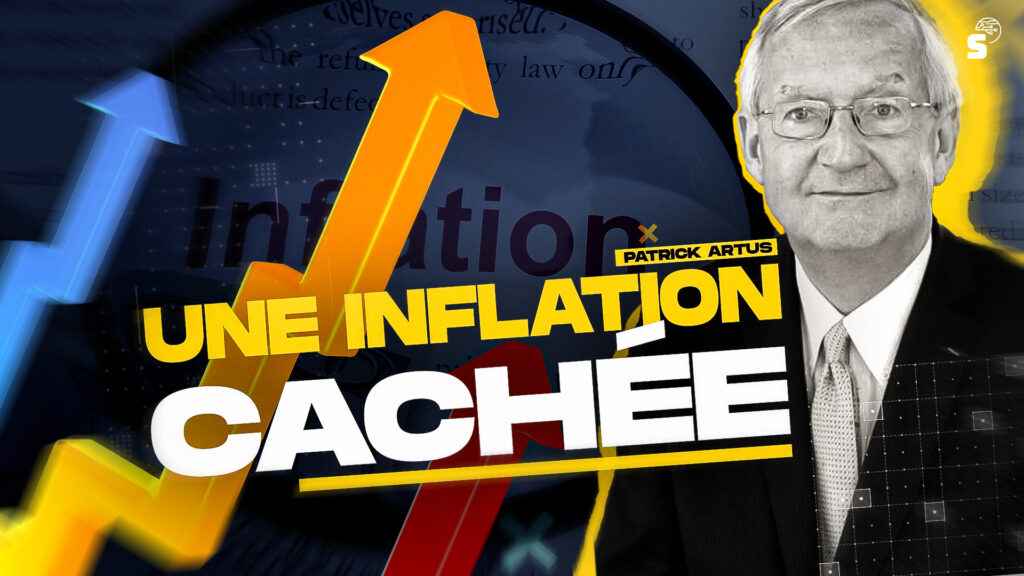Vincent Mortier, directeur des gestions d’Amundi, revient sur les grands enjeux de marché et : domination américaine, montée en puissance de la Chine technologique, regain d’intérêt pour l’or, et place à accorder à l’Europe dans les portefeuilles. Une réflexion stratégique sur la manière d’investir en Bourse dans le monde de demain.
Tech : la Chine avance à marche forcée
Vincent Bezault : Vous expliquiez dans la première partie de notre entretien qu’il fallait aujourd’hui environ 25 % de technologie U.S. dans un portefeuille, compte tenu du rôle moteur du secteur dans la performance des marchés. Mais cette exposition renvoie avant tout à la technologie américaine, dominante dans les grands indices. Est-ce le moment de diversifier et d’aller voir du côté de la technologie chinoise ?
Vincent Mortier : La technologie américaine reste dominante à bien des égards, sauf en Chine naturellement, mais cette position de suprématie commence à être contestée. Les grands groupes américains dégagent encore des marges colossales, portées par une avance réelle sur certaines technologies de pointe. Néanmoins, la Chine affiche une détermination sans faille à combler son retard, avec des investissements massifs et une stratégie parfaitement coordonnée entre l’État, les industriels et le secteur de la recherche.
Sur plusieurs segments, la Chine a déjà rattrapé, voire dépassé, les États-Unis : énergies renouvelables, véhicules électriques, robotique, ou encore intelligence artificielle. L’écart subsiste sur d’autres, notamment les semi-conducteurs, mais il se réduit rapidement. Les autorités chinoises ont d’ailleurs publié un plan stratégique quinquennal d’une grande clarté : l’un des premiers objectifs fixés par Xi Jinping est d’assurer une autonomie technologique complète sur les secteurs jugés vitaux pour la souveraineté nationale.
Ce plan à cinq ans, plus long qu’un mandat présidentiel américain, donne un cap lisible et stable. Et les Chinois ne plaisantent pas avec leurs engagements : lorsqu’ils fixent un objectif, ils le tiennent. Les moyens mobilisés sur la filière des puces électroniques sont considérables. Les contacts que nous avons sur place confirment qu’ils n’attendent pas cinq ans pour obtenir des résultats : leur horizon réel est de deux ans.
Le jour où la Chine aura comblé son retard technologique, voire pris l’avantage, les grands acteurs américains en pâtiront. Car la Chine n’agit pas seule : elle dispose d’alliés, de marchés alternatifs et de relais régionaux puissants. Même si les droits de douane américains ont freiné ses exportations vers les États-Unis, le pays a compensé en développant ses ventes vers l’Asie du Sud, l’Europe et l’Amérique latine. Cette capacité à redéployer son commerce extérieur est remarquable et confère à la Chine une résilience économique que peu de pays peuvent revendiquer.
Je ne doute pas qu’une bascule du leadership technologique interviendra dans les deux ou trois prochaines années. Les signaux sont déjà visibles : la « pause » d’un an décidée entre Pékin et Washington est révélatrice du nouvel équilibre des forces.
Chine vs U.S. : un rapport de force désormais symétrique
Vincent Bezault : Vous faites allusion à l’accord négocié entre Donald Trump et Xi Jinping, présenté à l’époque comme une victoire américaine. Mais lorsqu’on examine les détails, on constate que ce sont surtout les Chinois qui ont la main.
Vincent Mortier : Exactement. L’enjeu principal portait sur les terres rares, indispensables à la production de nombreuses technologies. Pékin a accepté un moratoire, mais en contrepartie, il a obtenu la poursuite de transferts technologiques et la réduction de certains droits de douane. Cela illustre bien l’évolution du rapport de force : la Chine n’est plus en position de faiblesse, elle est désormais l’égale des États-Unis sur le plan symbolique et stratégique.
C’est un tournant majeur : pour la première fois, les États-Unis se retrouvent face à un rival capable de les faire plier. L’image compte beaucoup en politique internationale. Et le fait que cet accord ait été signé en Corée du Sud, allié historique de Washington mais géographiquement proche de la Chine, ajoute encore à la portée symbolique de l’événement.
Chine : un marché à fort potentiel, mais sélectif
La technologie chinoise va continuer de progresser, c’est une évidence. En Bourse, le secteur a déjà fortement rebondi, notamment à Hong Kong. Les grandes valeurs, les équivalents des « Magnificent Seven » américains, ne sont pas forcément bon marché : tout le monde s’est précipité dessus. En revanche, le véritable potentiel se situe chez les acteurs innovants de taille moyenne, souvent méconnus en Occident, cotés à Shanghai plutôt qu’à Hong Kong.
Ces entreprises représentent la nouvelle génération technologique chinoise, celle qui créera la valeur de demain. Pour un investisseur particulier, il n’est pas simple d’y accéder directement, mais on peut le faire via des fonds thématiques ou des ETF sectoriels. Malgré la hausse récente, le marché reste attractif : la Bourse chinoise sort de trois années de baisse continue et demeure très en deçà de ses plus hauts historiques.
Alors que les marchés japonais, américains, allemands ou indiens sont revenus sur leurs records, la Chine reste « sous le pied ». Cela signifie qu’elle a encore un potentiel de rattrapage important, soutenu par plusieurs dynamiques : relance domestique, politique pro-natalité, et surtout investissements massifs dans la technologie.
Chine : une économie à un moment charnière
Tous ces éléments plaident pour une reprise durable de la croissance chinoise. Le pays entre dans une phase charnière : il ne s’agit plus seulement d’exporter, mais de rééquilibrer la croissance vers la consommation intérieure et l’innovation. La question clé, désormais, est de savoir si les profits des entreprises seront réellement redistribués aux actionnaires. C’est le principal point d’incertitude, mais les signaux récents sont plutôt positifs.
Les autorités chinoises sont conscientes que pour attirer les capitaux étrangers, elles doivent garantir la stabilité et la transparence. La Chine ne peut pas se permettre de décourager l’investissement international au moment où elle ambitionne de supplanter les États-Unis. Dans cette optique, je serais très surpris qu’elle revienne sur les avancées réalisées en matière de gouvernance ou qu’elle nationalise les profits du secteur privé.
Chine : de la crise immobilière à la relance par la bourse
Vincent Bezault : Certains investisseurs considèrent encore la Chine comme un marché trop risqué, en raison notamment du marasme immobilier persistant et de la faiblesse de la consommation intérieure. Les mesures esquissées par les autorités, à travers le dernier plénum du Parti, sont-elles réellement en mesure de relancer la dynamique économique ?
Vincent Mortier : La première chose à souligner, c’est que les autorités chinoises ont posé un diagnostic lucide de la situation économique. Reconnaître les déséquilibres est déjà une première étape vers leur correction. Le pays reste sur une trajectoire de croissance du PIB autour de 5 %, ce qui demeure considérable pour une économie de cette taille et malgré le déclin démographique.
Cette croissance est certes déséquilibrée – tirée avant tout par les exportations – mais elle reste remarquable dans un contexte mondial ralenti. La Chine conserve donc une résilience macroéconomique que beaucoup sous-estiment.
Chine : un modèle en mutation
Le grand défi est effectivement de rééquilibrer la croissance vers la consommation domestique. Les dirigeants chinois en sont parfaitement conscients et multiplient les signaux en ce sens. L’immobilier reste un sujet sensible : après plusieurs années de spéculation et de surinvestissement, le secteur s’est stabilisé, mais il demeure fragile.
Cette stabilisation ne signifie pas que les problèmes sont résolus, seulement qu’ils n’empirent plus. L’État a pris le contrôle du processus pour éviter une spirale baissière et protéger les ménages.
Le schéma mis en place est clair : il vise les investisseurs individuels et non les gros patrimoines. En Chine, une grande partie de l’épargne des ménages a historiquement été investie dans la pierre, perçue comme une source de revenu pour la retraite. L’objectif actuel du gouvernement est de permettre à ces épargnants de revendre leur logement sans perte, pour qu’ils puissent réallouer leur capital vers les marchés financiers.
Chine : le basculement vers les actions
Ce mouvement, nous le constatons sur le terrain. Dans nos coentreprises locales, notamment celle créée avec la Bank of China en 2019, nous observons depuis six à neuf mois un phénomène inédit : des investisseurs vendent leur logement pour placer leur épargne en actions.
C’est une première depuis notre présence en Chine. Jusqu’à présent, les flux étaient concentrés sur les fonds monétaires ou les produits de court terme obligataire. Désormais, l’appétit pour les actions se renforce.
Ce basculement est vertueux : la performance du marché entraîne de nouveaux flux, et ces flux alimentent à leur tour la performance. L’État y voit également un levier pour financer ses projets stratégiques et soutenir la croissance. Autrement dit, la bourse chinoise devient un instrument de politique économique, au même titre que l’immobilier l’était auparavant.
La bourse, nouveau moteur de prospérité
Vincent Bezault : Vous évoquez donc une sorte de transfert de l’« effet richesse » de l’immobilier vers les marchés d’actions ?
Vincent Mortier : Exactement. C’est le raisonnement tenu aujourd’hui par les autorités. Pendant des décennies, la prospérité chinoise reposait sur la hausse continue des prix de l’immobilier, qui soutenait la consommation et la cohésion sociale. Mais ce modèle a atteint ses limites.
L’idée est désormais de substituer à cet effet richesse immobilier un effet richesse boursier. Lorsque les ménages constatent que leurs placements financiers progressent, cela stimule la consommation. C’est une dynamique que l’on observe dans toutes les économies développées.
Le gouvernement accompagne ce mouvement en cherchant à rendre les entreprises plus rentables, plus transparentes et mieux capitalisées. C’est une évolution structurelle majeure : la Chine veut que ses entreprises deviennent des acteurs compétitifs à l’international, mais aussi qu’elles inspirent confiance à leurs propres citoyens investisseurs.
Une économie à l’équilibre instable, mais prometteur
Vincent Mortier : On entre donc dans une nouvelle phase. L’économie chinoise combine résilience, volonté politique, et flux d’épargne considérables à réorienter. C’est ce qui crée le potentiel d’un cercle vertueux entre performance boursière, confiance des ménages et financement des grands projets d’avenir.
Il faut aussi noter que la valorisation moyenne du marché chinois reste attractive, notamment comparée à d’autres grandes zones économiques.
Les autorités locales continuent de gérer la sortie progressive du cycle immobilier sans provoquer de choc, tandis que les banques publiques soutiennent les refinancements nécessaires. C’est une approche pragmatique, destinée à maintenir la stabilité tout en redirigeant les flux de capitaux.
Un pari sur la confiance
Vincent Bezault : Certains investisseurs restent sceptiques, estimant que la Chine n’est pas « investissable » en raison de la nature autoritaire de son régime. Que leur répondez-vous ?
Vincent Mortier : C’est un argument que j’entends souvent. Il est légitime de s’interroger sur le cadre politique, mais il faut garder une vision objective et comparative. La Chine n’est pas une démocratie, c’est un fait, mais cela ne signifie pas qu’elle est inapte à l’investissement. Beaucoup de pays où les capitaux occidentaux sont présents ne sont pas non plus des modèles démocratiques.
Si l’on commence à introduire un jugement moral dans les décisions d’investissement, on finit par ne plus investir que chez soi. Ce n’est ni réaliste, ni rentable.
Le monde est ce qu’il est, pas forcément ce qu’on voudrait qu’il soit. Se priver de la croissance chinoise, c’est se priver d’un vecteur majeur de création de valeur. Les investisseurs doivent donc raisonner en termes économiques, pas idéologiques.
Un marché qui attire à nouveau les flux
En résumé, la bourse chinoise devient un pilier de la stratégie économique du pays. Les ménages se tournent vers les marchés actions, les autorités favorisent cette évolution, et les entreprises chinoises renforcent leur attractivité.
C’est un mouvement profond, encore au début de son cycle, qui pourrait transformer durablement la structure du patrimoine financier chinois.
Pour les investisseurs internationaux, la Chine reste un marché complexe, exigeant de la sélectivité et une bonne compréhension des mécanismes locaux. Mais elle offre aussi des opportunités uniques, à condition d’adopter un horizon d’investissement de moyen à long terme.
Réallocation mondiale : le poids excessif des États-Unis dans les portefeuilles
Vincent Bezault : Si l’on regarde les grands indices mondiaux, la place des États-Unis y est démesurée. Vous citiez, dans la première partie de notre entretien, une pondération d’environ 75 % des États-Unis dans le MSCI World. Quelle part y occupe aujourd’hui la Chine ?
Vincent Mortier : Il faut d’abord préciser que le MSCI World ne comprend que les pays développés. Pour avoir une vision complète, il faut se référer à l’indice MSCI All Country World Index (ACWI), qui intègre également les marchés émergents. Dans cet indice global, les États-Unis pèsent 66 %, tandis que la Chine et l’Inde réunies ne représentent qu’environ 6 %. Ce déséquilibre est manifeste.
À court terme, il s’explique par la surperformance des marchés américains et par des choix méthodologiques propres aux fournisseurs d’indices : ils pondèrent les entreprises en fonction du flottant et non de leur capitalisation totale. Or, dans de nombreux groupes chinois ou indiens, une part importante du capital reste détenue par l’État ou par des familles, ce qui réduit mécaniquement leur poids dans les indices.
Mais structurellement, ce déséquilibre ne reflète pas la réalité économique mondiale. Chine et Inde devraient logiquement peser le double, voire davantage.
Un biais structurel des investisseurs internationaux
Vincent Bezault : Au-delà des indices, les portefeuilles institutionnels reflètent-ils ce même déséquilibre ?
Vincent Mortier : Oui, et de façon encore plus marquée. En moyenne, les grands investisseurs institutionnels mondiaux sont sous-pondérés sur la Chine, avec seulement 3 à 4 % d’exposition, bien en dessous de ce que justifierait son poids économique.
Cette situation n’a aucun sens stratégique dans une logique de long terme. Sur un horizon de dix à vingt ans, concentrer les deux tiers d’un portefeuille sur les États-Unis n’est pas rationnel.
Si l’on rebascule les indices boursiers en fonction du PIB mondial, ajusté du pouvoir d’achat (ce qu’on appelle les parités de pouvoir d’achat – PPP), la part des États-Unis dans l’économie mondiale tombe à 26 %. C’est déjà considérable, mais très éloigné des 66 % qu’ils représentent dans les portefeuilles. La vérité se situe quelque part entre ces deux chiffres.
Un risque caché ?
Il faut également garder à l’esprit qu’acheter des actions américaines, c’est aussi acheter du dollar. Or, tous les investisseurs n’ont pas nécessairement intérêt à concentrer leur patrimoine sur cette devise.
Si l’on décide de couvrir le risque de change, cela a un coût : environ 1,5 à 2 % par an de performance. Autrement dit, tous les dividendes perçus sur les actions américaines servent essentiellement à compenser ce coût de couverture.
Cet élément est souvent négligé dans les allocations, alors qu’il pèse lourdement sur les performances à long terme. Il faut donc raisonner en termes de risque global, pas seulement en termes de rendement boursier.
Vers un rééquilibrage progressif des portefeuilles
Vincent Bezault : Peut-on s’attendre à un rééquilibrage des portefeuilles dans les années à venir, pour tenir compte de ce déséquilibre entre les États-Unis et le reste du monde ?
Vincent Mortier : Oui, ce rééquilibrage est inévitable, mais il ne se produira probablement pas par des décisions volontaristes. Il interviendra plutôt de façon mécanique, à travers la normalisation des valorisations américaines.
Les valeurs américaines, notamment technologiques, ont connu une expansion de multiples exceptionnelle. Lorsque cette phase se stabilisera – ou se contractera – le poids des autres régions augmentera automatiquement dans les indices. Ce sera un effet de réallocation passive, déclenché par la simple correction relative des marchés.
Cette déflation des valorisations aux États-Unis pourrait d’ailleurs être le déclencheur d’une nouvelle phase d’investissement mondial, où les capitaux reviendraient vers l’Asie ou l’Europe, régions encore sous-représentées et sous-valorisées.
Des flux encore prudents mais appelés à croître
Vincent Bezault : Pourtant, on a vu ces dernières années les banques américaines tenter de s’implanter plus fortement en Chine, signe qu’elles percevaient ce potentiel. Est-ce toujours le cas ?
Vincent Mortier : L’enthousiasme initial s’est nettement atténué. Le marché chinois reste fermé et complexe, et les entreprises américaines n’y sont pas toujours bienvenues dans le contexte actuel.
Cela explique que les flux étrangers vers la Chine demeurent prudents. En revanche, on observe une forte incitation domestique à investir sur la bourse chinoise, alimentée par la réallocation de l’épargne des ménages dont nous parlions précédemment.
Le bassin d’épargne chinois est colossal. Les Chinois sont historiquement les plus gros épargnants du monde, avec des taux d’épargne très supérieurs à ceux des pays occidentaux. Si une fraction significative de cette épargne est redirigée vers les marchés actions, cela représentera un soutien durable et massif à la valorisation des actifs domestiques.
La Chine, future Inde des portefeuilles mondiaux ?
Ce phénomène n’est pas inédit : il suffit d’observer ce qui s’est passé en Inde. L’investisseur indien a une culture profondément orientée vers les actions, ce qui a contribué à maintenir la bourse indienne à des niveaux de valorisation élevés depuis des décennies.
Le jour où les ménages chinois adopteront la même approche, en investissant de manière régulière et structurelle en actions, le marché connaîtra le même type de soutien endogène. Ce serait une transformation majeure pour la Chine, mais aussi pour la structure des flux mondiaux.
Ce basculement ne se fera pas du jour au lendemain, mais il est en marche. Les premiers signes sont visibles, et le potentiel reste immense. Pour les investisseurs internationaux, il s’agit d’un mouvement de fond, qui devrait s’amplifier dans les prochaines années.
L’or, valeur refuge structurelle
Vincent Bezault : On a assisté récemment à une ascension spectaculaire de l’or, qui semble traduire une crainte des marchés vis-à-vis des monnaies, compte tenu des niveaux de dette publique et du ralentissement monétaire américain. Est-ce un phénomène passager ou une tendance de fond ?
Vincent Mortier : C’est une tendance structurelle, pas un simple emballement spéculatif. La montée de l’or s’explique par des mouvements d’allocation profonds, initiés d’abord par les banques centrales et les fonds souverains, puis relayés par les investisseurs particuliers.
Pendant plusieurs décennies, depuis la fin des accords de Bretton Woods, les banques centrales avaient réduit la part de l’or dans leurs réserves. Mais cette logique a commencé à changer il y a deux ou trois ans. Le conflit en Ukraine a servi d’électrochoc : certains pays ont pris conscience que la détention de réserves en devises occidentales comportait un risque géopolitique.
La fin de l’illusion du dollar sans risque
La confiscation de réserves russes et la multiplication des sanctions financières ont rappelé une évidence : une devise, aussi solide soit-elle, n’est pas un actif neutre. Elle dépend d’un cadre politique.
Face à cette prise de conscience, plusieurs banques centrales – la Chine, bien sûr, mais aussi celles d’Asie centrale et du Moyen-Orient – ont décidé de diversifier leurs réserves.
Leur raisonnement est simple : elles détenaient trop de dollars, or ces avoirs peuvent être gelés ou dévalorisés. En comparaison, l’or physique offre une sécurité absolue, sans risque de contrepartie. D’où le retour progressif de l’or dans la composition des réserves officielles.
Cette première vague d’achats institutionnels a enclenché la hausse du métal jaune. Elle répondait d’abord à un objectif de protection contre les sanctions. Mais depuis quelques mois, une deuxième phase s’est ouverte : celle du risque de débasement monétaire global.
L’or comme antidote
Le monde fait face à un risque de dépréciation généralisée des monnaies fiduciaires, conséquence directe des politiques de dettes et de création monétaire. Dans ce contexte, l’or joue à plein son rôle d’étalon de pouvoir d’achat.
Il ne s’agit pas d’un actif spéculatif, mais d’un actif d’assurance : il ne rapporte rien, mais il préserve la valeur.
Depuis deux ans, on assiste donc à une reconstitution de stocks d’or par les États, après plusieurs décennies de ventes. Ce phénomène a alimenté la deuxième jambe de la hausse, fondée sur des achats fondamentaux et non spéculatifs.
La troisième phase, plus récente, est celle des investisseurs particuliers. Face à la hausse du métal, ils ont voulu participer à ce mouvement tangible, à travers des achats d’or physique – pièces, lingots, Napoléons – mais aussi via des fonds indiciels adossés à l’or.
Or : une demande généralisée et durable
Nous l’observons directement chez Amundi. Notre produit adossé à de l’or physique a récemment franchi les 10 milliards d’euros d’encours, ce qui témoigne d’un engouement inédit. L’intérêt vient désormais aussi bien des institutionnels que des particuliers.
On entend souvent dire que lorsque les particuliers arrivent, c’est la fin du mouvement. Ce n’est pas le cas ici. Même si la volatilité reste présente, la demande structurelle des banques centrales asiatiques demeure forte, soutenue par des excédents commerciaux considérables.
La Chine, par exemple, continue d’accumuler des réserves de change record, qu’elle préfère investir en or plutôt qu’en dollars. Ces flux d’achat massifs assurent un plancher de soutien durable au métal jaune.
Or : des perspectives encore haussières
Vincent Bezault : Jusqu’où ce mouvement peut-il aller ?
Vincent Mortier : Compte tenu de ces dynamiques, je ne serais pas surpris de voir l’or atteindre 5 000 à 6 000 dollars l’once dans l’année à venir.
L’équation est simple : la demande institutionnelle reste forte, la demande des particuliers s’intensifie, et l’offre mondiale est structurellement contrainte.
Il faut en avoir dans un portefeuille, mais de manière raisonnée. Une exposition de 5 à 10 % paraît appropriée : c’est un actif de diversification, pas de spéculation.
Au-delà, on perdrait en équilibre global. L’or ne rapporte pas d’intérêts, ne verse pas de dividendes et nécessite des coûts de conservation. Il faut donc le considérer comme une assurance patrimoniale, et non comme un moteur de performance.
Les minières et métaux stratégiques en embuscade
Vincent Bezault : Certains préfèrent jouer la hausse du métal via les sociétés minières aurifères. Est-ce une alternative crédible ?
Vincent Mortier : Oui, mais avec prudence. Les minières ne reproduisent pas parfaitement la performance de l’or : leur corrélation n’est pas de 1 pour 1. Pendant longtemps, elles ont même sous-performé le métal.
Aujourd’hui, leur rentabilité s’améliore car les cours élevés couvrent largement les coûts d’extraction. Le profit marginal des producteurs augmente plus vite que le prix de l’or, et de nouveaux projets de forages deviennent rentables.
Plus largement, je pense que le secteur minier dans son ensemble a été sous-valorisé ces dernières années. Nous sommes probablement au début d’un supercycle des métaux, porté par la transition énergétique et les besoins en matières premières stratégiques : terres rares, cuivre, uranium, etc.
Les grands groupes miniers diversifiés offrent aujourd’hui une exposition équilibrée à cette thématique, tout en réduisant le risque spécifique d’un seul métal ou d’une seule zone géographique.
Europe : la prudence payante ?
Vincent Bezault : Après les États-Unis, la Chine et l’or, parlons un peu de l’Europe. Tactiquement, il y a toujours des opportunités sur certains titres, mais d’un point de vue plus global, l’Europe conserve-t-elle aujourd’hui un intérêt stratégique pour les investisseurs ?
Vincent Mortier : C’est une question essentielle. À court et moyen terme, l’Europe ne présente pas de fort potentiel de croissance. La région affiche des taux de croissance faibles, autour de 1 %, et parfois nuls : le dernier trimestre s’est soldé par zéro croissance.
Même si l’on peut être un peu plus optimiste à long terme – notamment grâce à la reprise du commerce allemand ou à la transition énergétique – il faut reconnaître que l’Europe reste un marché mature, peu dynamique sur le plan économique.
Une croissance faible mais une visibilité solide
L’Europe souffre d’un manque d’innovation monétisable : elle n’a pas d’équivalents aux grandes valeurs technologiques américaines. Son tissu boursier reste dominé par des secteurs traditionnels : industrie, banque, luxe, énergie, matériaux, etc.
Mais cela ne veut pas dire qu’il faille l’écarter. L’Europe est devenue, comme le Japon à une époque, le paradis des valeurs de rendement.
On y trouve des entreprises solides, peu endettées, générant des dividendes élevés et offrant une volatilité plus faible que leurs homologues américaines.
Dans un contexte incertain, marqué par des chocs successifs et une volatilité macroéconomique accrue, ces caractéristiques sont précieuses. Pour un investisseur cherchant stabilité et revenu, les valeurs de rendement européennes jouent un rôle comparable à celui des obligations convertibles : elles offrent un rendement régulier, tout en conservant un potentiel de valorisation si l’activité repart.
Des secteurs qui ont déjà beaucoup donné
Vincent Bezault : Quelles sont, selon vous, les zones du marché européen où il reste encore du potentiel ?
Vincent Mortier : Si l’on observe le marché de façon plus granulaire, on constate que la hausse récente s’est concentrée sur une poignée de secteurs clés : les banques, la défense, et les électriciens ou fournisseurs de matériel électrique, ces derniers bénéficiant de la thématique intelligence artificielle et de la transition énergétique.
Ces trois segments ont logiquement surperformé. Mais après une telle progression, il faut reconnaître que le potentiel de hausse résiduel est désormais plus limité. Les valorisations se sont normalisées : ces secteurs ne sont plus particulièrement bon marché, même s’ils ne sont pas encore surévalués.
Pour les banques, par exemple, la phase de rebond semble terminée. Elles se situent aujourd’hui à des niveaux d’équilibre cohérents avec leur rentabilité actuelle. La défense reste soutenue, mais la visibilité est déjà intégrée dans les cours. Quant aux valeurs liées à l’IA industrielle, elles ont bénéficié d’un puissant effet d’anticipation, et il faut désormais être sélectif.
Des marchés européens dans leur moyenne historique
Globalement, les marchés européens ne sont ni chers ni bon marché : ils se situent dans leur moyenne historique de valorisation.
L’Europe ne doit pas être achetée dans l’espoir d’un boom boursier, mais pour ses dividendes et sa visibilité bénéficiaire. Dans un environnement heurté, c’est une valeur refuge relative.
On ne peut pas exclure quelques bonnes surprises, notamment dans certains secteurs cycliques si la croissance se redresse. Mais, à l’inverse, le risque d’effondrement est limité. Contrairement aux États-Unis, où le marché peut connaître des phases de boom and bust, l’Europe est structurellement plus lisse.
Moins d’euphorie, mais aussi moins de krachs : c’est une autre forme de stabilité.
Europe : un marché pour investisseurs patients
Pour les investisseurs européens qui détiennent leur patrimoine en euros, le marché européen conserve un attrait évident.
D’une part, cela supprime le risque de change, souvent coûteux à couvrir. D’autre part, la distribution de dividendes y reste généreuse et globalement soutenable.
Bien sûr, il faut rester sélectif : tous les dividendes ne sont pas durables. Certains peuvent disparaître, mais d’autres progressent régulièrement. Les entreprises qui ont su maintenir une croissance de leurs dividendes sur plusieurs années méritent une attention particulière.
Elles constituent le cœur des portefeuilles de rendement européens, recherchés pour leur stabilité dans un monde incertain.
Retrouvez la première partie de cet entretien avec Vincent Mortier ici
Les valeurs de qualité qui constituent les Sélections Elite sont toujours délaissées. Nous continuons à y voir une opportunité, car le marché peut raconter ce qu’il veut, in fine la qualité finit toujours par payer.