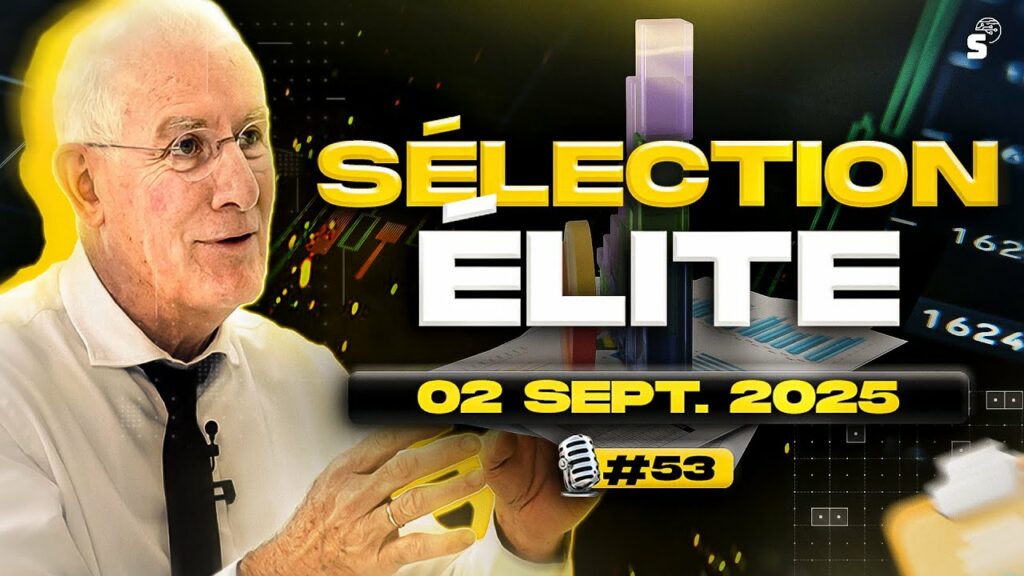Patrick Artus, conseiller chez Ossiam, analyse les conséquences du niveau de la dette publique américaine, l’évolution des taux longs, les perspectives pour le dollar et les stratégies des banques centrales en particulier de la BCE qui suit un chemin potentiellement dangereux. Il livre sa lecture des risques macroéconomiques mondiaux qui pèsent sur les marchés.
Vincent Bezault : commençons par les États-Unis. Donald Trump ne rate aucune occasion d’attaquer Jerome Powell, l’encourageant à baisser les taux. Pensez-vous que le président de la Fed cédera à ces pressions ?
Patrick Artus : Absolument pas. Jerome Powell ne suit en rien les “conseils” de Donald Trump – ce ne sont d’ailleurs pas vraiment des conseils, mais plutôt des invectives. Il mène une politique monétaire indépendante, fondée sur l’analyse de la conjoncture.
Actuellement, l’économie américaine résiste bien : les créations d’emplois sont robustes, le chômage reste faible, et les indicateurs avancés des services, comme l’ISM, signalent une reprise de l’activité. Quant à l’inflation, on attend encore les données de juin, mais pour l’instant, elle ne montre pas de signe de reprise. Powell reste donc dans une position d’observation, avec des anticipations de croissance plus faibles et une inflation en hausse à cause des droits de douane. Cela crée un dilemme.
Je pense que Powell procédera à une légère baisse des taux d’ici la fin de son mandat en mai, mais il n’aura pas de marge de manœuvre pour un assouplissement significatif. Une ou deux baisses de 25 points de base me semblent envisageables.
Le successeur de Powell, Trump et les taux d’intérêt
Vincent Bezault : Et ensuite ? Que peut-on attendre de son successeur, vraisemblablement nommé par Donald Trump ?
Patrick Artus : Ce successeur sera très probablement favorable à une baisse plus marquée des taux. C’est conforme à l’intérêt politique de Trump, en particulier pour le secteur immobilier. On peut donc envisager que les taux soient progressivement abaissés jusqu’à 3 % d’ici fin 2026, si le successeur convainc les autres membres du FOMC.
Les anticipations actuelles du marché sur l’évolution des taux d’intérêt américains me paraissent tout à fait raisonnables.
Vincent Bezault : Quelles conséquences cela aurait-il pour le marché obligataire américain ?
Patrick Artus : Deux forces contraires s’exercent sur les taux longs américains. D’un côté, l’anticipation de baisse des taux courts exerce une pression à la baisse. De l’autre, la politique budgétaire expansionniste avec le “Big Beautiful Bill” entraînera un déficit supérieur à 7 % du PIB sur les dix prochaines années, soit une hausse de la dette publique de 4 points de PIB par an.
Résultat : les taux longs resteront légèrement orientés à la hausse. Le taux à 10 ans, actuellement autour de 4,40 %, pourrait atteindre 4,60 % d’ici fin 2024, voire 5 % fin 2025, sans pour autant atteindre les 6 % redoutés au moment de la guerre commerciale.
Droits de douane et inflation : quels impacts ?
Vincent Bezault : Les droits de douane sont un facteur clé. Quel en serait l’effet sur l’inflation ?
Patrick Artus : Une étude de l’université de Yale montre que les droits de douane américains moyens sont passés de 2 % à 15 % depuis l’arrivée de Trump. Cela équivaut à une hausse de 12 % des prix à l’importation, qui, via leur pondération dans le PIB, se traduisent par une hausse de 0,75 point de l’inflation des prix à la consommation.
Si cet effet est durable, l’inflation sous-jacente pourrait passer de 2,8 % à 3,5 %, avec pour conséquence une tension sur les taux longs, surtout si les salaires suivent, dans un contexte de marché du travail plus tendu.
Pour l’instant, les anticipations d’inflation à long terme ne bougent pas, mais si cette hausse devient structurelle, on pourrait voir les taux longs grimper davantage.
Vincent Bezault : Autre facteur à surveiller : l’appétit des investisseurs étrangers pour la dette américaine…
Patrick Artus : En effet, un tiers de la dette américaine est détenue par des non-résidents : Europe, Japon, Émirats, Caïmans (pour des clients anonymes). Leur comportement est incertain. Si la Fed baisse les taux et que son successeur va encore plus loin en 2026, le dollar pourrait glisser davantage, ce qui rendrait les treasuries moins attractifs pour les étrangers.
Dollar : pas de concurrent sérieux à l’horizon
Vincent Bezault : Peut-on aller jusqu’à envisager une remise en cause du rôle du dollar comme monnaie de réserve ?
Patrick Artus : Je n’y crois pas du tout. Aucune monnaie ne peut aujourd’hui remplacer le dollar. L’euro est segmenté, sans dette fédérale. Le yen est trop petit. Le renminbi n’est pas convertible et n’a pas d’attrait politique international.
La part du dollar dans les transactions commerciales, les réserves de changes ou les émissions de dette ne recule pas. Donc pas de déclin du billet vert en vue.
Le taux de change pourrait certes évoluer avec les écarts de taux entre les États-Unis, l’Europe et le Japon, mais ce ne serait qu’un ajustement technique, pas un effondrement.
Vincent Bezault : Vous évoquez un phénomène de pentification de la courbe des taux ?
Patrick Artus : Exactement. On assiste à une baisse des taux courts aux États-Unis et à une hausse des taux longs en Europe, notamment en Allemagne et en France. Ce mouvement traduit l’inquiétude des marchés obligataires européens sur les déficits publics, surtout en Allemagne où les taux sont déjà au-dessus de 2,60 %.
BCE : baisse des taux et contraction du bilan
Vincent Bezault : La BCE a-t-elle terminé son cycle de baisse des taux ?
Patrick Artus : Elle est sans doute à son taux terminal, autour de 2 %. Ce qui est surprenant, c’est qu’en parallèle de cette politique monétaire plus souple, elle réduit très activement la taille de son bilan, ce qui constitue un resserrement monétaire par la liquidité.
Contrairement à la Fed, dont le bilan est stable, la BCE a déjà réduit son bilan de 2 000 milliards d’euros depuis novembre 2022. Elle envisage même de revenir au niveau d’avant-Covid, soit 1 500 milliards de baisse supplémentaire.
Cela aurait un impact direct sur les taux longs : +35 points de base en Allemagne, +40 à +45 points en Italie et Espagne pour chaque tranche de 1 000 milliards. Cela représente un facteur important de pentification en zone euro.
Une politique difficile à comprendre
Vincent Bezault : Pourquoi la BCE adopte-t-elle une telle stratégie ?
Patrick Artus : Elle considère que le quantitative easing (QE) était une politique exceptionnelle, et veut donc lui opposer un quantitative tightening (QT) symétrique. Elle n’anticipe pas de besoin structurel accru de liquidité depuis 2019.
C’est difficile à comprendre, car l’inflation reste modérée (autour de 2 % hors énergie et alimentation) et la croissance est atone : +0,7 % cette année, en dessous du potentiel. Dans ce contexte, la BCE devrait plutôt soutenir l’investissement.
Vincent Bezault : Elle pourrait pourtant jouer un rôle majeur dans la transition énergétique.
Patrick Artus : Exactement. Le rapport Draghi évoque 800 milliards d’euros par an nécessaires pour financer la transition, dont 450 milliards d’investissements publics. Cela justifierait un QE ciblé, finançant uniquement des projets liés à la transition énergétique, via des émissions de dettes communes. Mais la BCE n’en parle jamais.
Aujourd’hui, sa politique est paradoxale : expansionniste sur les taux courts, restrictive sur la liquidité.
La dette américaine face aux défis asiatiques et pétroliers
Vincent Bezault : Revenons à la dette américaine. Le Japon, l’un des grands financeurs, pourrait-il poser problème ?
Patrick Artus : Le marché du travail japonais est tendu, avec des hausses de salaires généralisées. L’inflation sous-jacente dépasse 3 %, ce qui pousse la Banque du Japon à assouplir son contrôle des taux et à relever progressivement ses taux longs.
Cela pourrait rendre les obligations japonaises plus attractives, incitant les investisseurs domestiques à revenir sur le marché national au détriment des treasuries.
Vincent Bezault : D’autres risques de désengagement pour les États-Unis ?
Patrick Artus : Oui. Si l’Europe garde son épargne pour la réindustrialisation et la défense, c’est 400 milliards de dollars de moins qui partiraient vers les États-Unis chaque année.
Ajoutez à cela une surproduction de pétrole, avec un baril autour de 68 dollars. Si les cours baissent à 55 dollars, les excédents extérieurs des pays producteurs (Émirats, Arabie Saoudite) pourraient s’évaporer. Ils achèteraient donc moins de dette américaine.
Résultat : un tiers de la demande pour les treasuries pourrait disparaître, entraînant une pantification bien plus marquée de la courbe des taux américaine.
Fonds propres des banques américaines : un faux débat
Vincent Bezault : La baisse des exigences de fonds propres des banques américaines ne va-t-elle pas relancer la demande pour les treasuries ?
Patrick Artus : C’est un faux débat. Les treasuries ne consomment pas de fonds propres, donc la baisse des ratios ne change rien à leur détention.
Les banques réduisent leur exposition au private equity, aux actions ou au crédit, mais elles n’ont jamais cessé d’acheter des treasuries. L’argument selon lequel JPMorgan ou d’autres grandes banques pourraient en acheter plus grâce à la réforme réglementaire me semble infondé.
Retrouvez l’intégralité de cet entretien en cliquant sur la vidéo ci-dessus