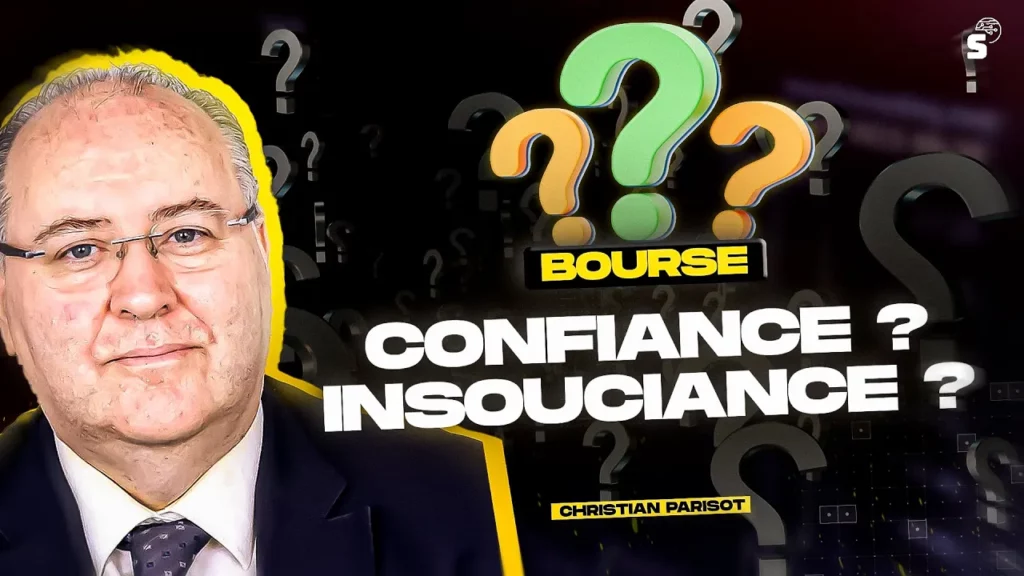Laurent Lamagnère, analyste chez AlphaValue, livre à Vincent Bezault une lecture détaillée de la manière dont les investisseurs peuvent ajuster leur exposition sectorielle selon la phase du cycle économique. Grâce à une « boussole » en Bourse qui croise la dynamique de croissance et l’évolution de la courbe des taux, il explique quelles valeurs privilégier, lesquelles alléger, et comment intégrer les réalités du marché pour éviter les erreurs stratégiques.
Laurent Lamagnère détaille phase par phase, les secteurs à privilégier, ceux à alléger, mais également les limites de cet outil utile mais non infaillible.
Boussole sectorielle : un guide pour se repérer dans le cycle
Vincent Bezault : Quand on est investisseur, la question revient sans cesse : à quel moment effectuer une rotation sectorielle ? Autrement dit, comment savoir quand surpondérer certains secteurs et réduire l’exposition à d’autres ? Vous êtes venu avec un schéma qui se veut une boussole. À l’écran, cela ressemble à un tourbillon, mais vous avez aussi préparé un tableau plus lisible. Expliquez-nous l’idée générale.
Laurent Lamagnère : L’outil est simple dans son principe : il découpe le cycle économique en quatre phases — rebond, expansion, fin de cycle et récession — qui se succèdent avant de recommencer. Chaque phase se définit par la combinaison de deux variables. D’un côté, la dynamique de la croissance : accélération ou ralentissement. De l’autre, l’évolution de la courbe des taux : son aplatissement ou sa pentification selon que les taux courts ou les taux longs bougent le plus. En croisant ces paramètres, on obtient quatre cadrans qui décrivent des configurations macroéconomiques typiques et, par ricochet, des comportements sectoriels récurrents.
Dans la phase de rebond, on sort d’une récession : la croissance redémarre, l’inflation reste basse, les taux courts demeurent faibles tandis que les taux longs remontent, ce qui pentifie la courbe. On parle de pentification baissière (bear steepening) parce que la pente s’accentue par vente de la partie longue.
Dans la phase d’expansion, la croissance accélère et l’inflation s’installe. Les marchés anticipent que la banque centrale relèvera les taux courts : on vend la partie courte, ce qui provoque un aplatissement baissier (bear flattening) — les taux courts montent plus vite que les longs.
En fin de cycle, la croissance ralentit. Les taux courts restent élevés (pas encore de détente monétaire), mais les investisseurs achètent la partie longue pour se protéger, faisant baisser les taux longs. La courbe s’aplatit à la hausse (bull flattening).
Enfin, en récession, la banque centrale baisse ses taux : les taux courts reculent franchement, les taux longs bougent peu ou moins vite. On assiste à une pentification haussière (bull steepening) liée à l’achat de la partie courte (ou, plus exactement, au soulagement sur les taux courts). Cette cartographie, même théorique, éclaire la rotation sectorielle et guide les pondérations au sein des actions.
Phase de rebond : le retour de la croissance et la prime aux cycliques
Vincent Bezault : Allons-y phase par phase. Dans un rebond, on sort de la récession : c’est le moment où les taux longs repartent, les taux courts ne bougent pas encore. Qu’est-ce que cela implique pour l’allocation ?
Laurent Lamagnère : Le message est clair : la confiance revient, la croissance repart de l’avant, et le marché se réexpose aux secteurs les plus sensibles à l’activité. On privilégie les secteurs cycliques — biens industriels, consommation discrétionnaire, finance — parce que leur structure de profits est étroitement corrélée à l’activité.
Dans cette pentification baissière de la courbe, les banques apparaissent en première ligne. Leur modèle repose sur la transformation de maturité : emprunter à court terme et prêter à long terme. Une courbe plus pentue élargit leurs marges d’intermédiation. Et comme l’économie repart, le coût du risque — ces pertes sur créances qui s’envolent en crise — tend à rester bas voire à diminuer. C’est un double soutien : marges plus confortables et risques mieux contenus.
À l’inverse, on a tendance à alléger les défensives, surtout celles à fort dividende. Lorsque les taux longs remontent, les rendements offerts par ces valeurs paraissent moins attractifs face aux obligations, et leur profil de croissance ne capte pas le supplément d’activité de la même façon que les cycliques. D’où une sous-pondération relative à ce stade.
Phase d’expansion : l’économie accélère, la vigilance s’impose
Vincent Bezault : Dans l’expansion, la croissance accélère et l’inflation progresse. Les taux courts montent plus vite que les taux longs ; c’est l’aplatissement baissier. Quelles conséquences ?
Laurent Lamagnère : Le premier réflexe, c’est la prudence vis-à-vis des sociétés à fort levier. La hausse des taux d’intérêt renchérit le coût de la dette : plus le bilan est lourd, plus la sensibilité des bénéfices est forte. Il faut donc scruter le levier financier indépendamment du secteur.
Pour le cœur d’allocation, la dynamique de croissance reste favorable aux segments qui tirent parti des investissements des entreprises. Les technologies et les services informatiques s’imposent, de même que les services aux entreprises. Dans la continuité du rebond, on garde une exposition aux industriels et aux matériaux : l’accélération de l’activité nourrit leurs carnets.
Les défensives demeurent sous-pondérées. Les utilities et les télécoms n’affichent pas, en général, de hausse de profits proportionnelle à l’expansion ; leur trajectoire est plus étale à travers le cycle. Tant que la croissance accélère, le marché récompense davantage les secteurs pro-cycliques.
Fin de cycle : ralentissement et repositionnement défensif
Vincent Bezault : Puis vient la fin de cycle. Les taux longs commencent à baisser, les taux courts restent élevés ; c’est l’aplatissement haussier. Comment repositionner un portefeuille ?
Laurent Lamagnère : L’économie ralentit, et le marché anticipe l’atterrissage. Dans ce schéma, on réduit les cycliques et on se replie sur les segments défensifs dont les profits sont moins dépendants de la conjoncture : santé, consommation de base, distribution alimentaire, utilities et télécoms. Comme les taux longs baissent, les valeurs à gros dividendes retrouvent de l’attrait : leur rendement relatif devient plus compétitif et leur visibilité de cash-flows rassure.
Il faut, a contrario, alléger les technologies et les services aux entreprises — tous ces segments sensibles à la croissance. Le marché se défend, recherche la résilience et, progressivement, re-évalue le risque.
Récession : sécuriser son portefeuille
Vincent Bezault : La dernière étape est la récession. Les banques centrales ont baissé les taux courts, la courbe se pentifie à la hausse. Où se placer, et que faire de l’exposition actions ?
Laurent Lamagnère : En récession, la croissance devient faible voire négative. Les banques centrales activent l’arme monétaire : les taux courts reculent franchement, plus vite que les taux longs, d’où cette pentification haussière. Si l’on doit rester investi en actions, on reste cramponné aux défensives — santé, consommation de base, utilities, télécoms — car la demande y est moins cyclique. Mais en allocation pure, il n’est pas aberrant de réduire fortement la poche actions, voire de la mettre à zéro, au profit de l’obligataire ou d’actifs de couverture comme l’or.
Le cas des banques divise. Théoriquement, une courbe plus pentue leur profite. Mais la récession fait peser un risque plus élevé sur le coût du risque : davantage de défauts potentiels de clients, une qualité d’actifs sous pression. D’où le débat récurrent : faut-il entrer sur les bancaires pendant la récession au motif de la courbe, ou attendre que le cycle reparte et que la visibilité du risque s’améliore ?
Limites : incertitudes et décalages géographiques
Vincent Bezault : Vous insistez : ce n’est pas une martingale. Où l’outil montre-t-il ses limites ?
Laurent Lamagnère : D’abord, il est difficile de savoir avec précision où l’on se situe dans le cycle. Les durées des phases varient et il n’est pas rare qu’une économie saute presque une phase : le passage peut être rapide, peu visible en temps réel. Même pour les économistes, la datation du cycle est un exercice délicat.
Ensuite, il y a les décalages géographiques. Une société globale — prenez un groupe de luxe par exemple — réalise une part de ses profits aux États-Unis, une autre en Chine, une autre en Europe. Or, ces zones ne sont pas synchrones : l’une peut être en rebond quand l’autre est en fin de cycle. Pour l’investisseur, cela complexifie la lecture : une même entreprise agrège des cycles différents.
Enfin, n’oublions pas que le marché anticipe. On peut avoir raison sur la position dans le cycle économique, mais arriver trop tard si le marché a déjà joué le scénario. La boussole oriente, elle ne prédit pas l’avenir ; il faut la pondérer par la réalité microéconomique, la connaissance des entreprises et une analyse financière complète.
A quelle phase du cycle en sommes-nous aujourd’hui ?
Vincent Bezault : Si l’on applique cette grille, où vous situez-vous actuellement ? Quelle lecture privilégiez-vous pour l’allocation ?
Laurent Lamagnère : Notre lecture est que nous sommes plutôt en fin de cycle, avec la perspective d’entrer dans une période récessive. Côté valorisations, nous observons qu’elles sont élevées : sur la plupart des segments, elles se situent au-dessus de la moyenne de long terme, parfois de plus d’un écart-type, en se référant au price-to-book (capitalisation rapportée à la valeur des fonds propres). Nous aimons cet indicateur parce qu’il est plus stable dans le temps qu’un cours/bénéfice ou qu’un VE/EBITDA.
Dans ce contexte, notre surpondération va à des profils défensifs et visibles : la distribution alimentaire, les télécoms et les sociétés d’infrastructures — pensez aux concessionnaires et aux acteurs dont les flux sont relativement prévisibles. Cela n’exclut pas, naturellement, qu’on trouve encore des poches d’attrait, mais la discipline s’impose avec des marchés qui ont déjà fortement rebondi.
Les exceptions à la règle : politique et tendances structurelles
Vincent Bezault : La théorie dirait : en fin de cycle, on allège les biens d’équipement. Pourtant, en Europe, on voit des plans de relance, notamment en Allemagne. Certaines entreprises, y compris françaises, pourraient en bénéficier. Comment arbitrez-vous ?
Laurent Lamagnère : C’est précisément là qu’apparaissent les limites d’une grille trop mécanique. Il y a des décisions politiques qui modifient la trame macroéconomique. Le plan de relance allemand constitue un soutien pour des acteurs exposés à ce marché ; parmi eux, des maisons suisses, allemandes, mais aussi françaises. La lecture purement cyclique serait de réduire cette poche ; la réalité nous incite à une vision plus nuancée.
Par ailleurs, un segment a explosé : tout ce qui touche aux data centers et à l’intelligence artificielle. Cela génère une demande en équipements et infrastructures spécifiques. Là encore, la boussole est utile pour la grande orientation, mais on doit intégrer le réel : investissements spécifiques, contraintes et opportunités sectorielles. Résultat : nous restons plus positifs sur certains équipementiers que ne le dirait la théorie, surtout lorsqu’ils sont exposés au marché allemand.
Santé et pharmacie : un potentiel malgré les vents contraires
Vincent Bezault : Toujours dans cette logique de fin de cycle, la théorie suggère de ré-exposer la santé et la pharmacie. Or, medtech comme big pharma souffrent. Comment l’expliquer et quelle position adopter ?
Laurent Lamagnère : On observe une désaffection qui tient à plusieurs éléments. D’abord, des craintes sur la position américaine vis-à-vis des produits de santé, avec la menace de droits de douane élevés. Même si, a priori, l’accord annoncé entre l’Union européenne et les États-Unis évoque une base normalisée à 15 %, l’épée de Damoclès reste là. Ensuite, pour les sociétés européennes, la nécessité d’investir pour créér des capacités de production aux États-Unis — des CAPEX lourds — pèse temporairement sur les cash-flows.
Pour autant, notre appréciation de long terme demeure positive pour la pharma. À court terme, les mois à venir peuvent être agités ; à moyen/long terme, la visibilité sur la demande et la résilience des modèles défensifs justifient une exposition réfléchie. C’est une question de tempo : absorber les CAPEX, clarifier le cadre commercial avec les États-Unis, puis laisser parler les fondamentaux.
Les secteurs à privilégier actuellement
Vincent Bezault : Si l’on résume vos priorités sectorielles dans la configuration actuelle, quelle est la hiérarchie ?
Laurent Lamagnère : Nous surpondérons les infrastructures — avec des acteurs comme les concessionnaires — pour leur visibilité de flux. Nous aimons la distribution alimentaire, typiquement défensive, et les télécoms. Dans un environnement de fin de cycle où les taux longs reflueraient ou se stabiliseraient bas, les valeurs à gros dividendes récupèrent une prime relative : leur rendement devient plus attractif. Cette logique de durée et de visibilité reste centrale tant que la macro pointe vers un ralentissement.
Banques : une dynamique durable ?
Vincent Bezault : Un mot sur les banques. Vous avez souvent défendu l’idée qu’il restait du chemin à faire, malgré le débat récurrent sur le timing.
Laurent Lamagnère : Plusieurs points conjugués nous rendent constructifs. D’abord, au fil des publications, le coût du risque — certes variable selon les maisons — demeure globalement maîtrisé. On a vu ici ou là des remontées — HSBC a signalé une hausse — mais rien qui change structurellement la lecture d’ensemble. Ensuite, l’environnement de taux reste porteur : même avec des allers-retours, la courbe demeure compatible avec des marges d’intermédiation correctes.
Surtout, à mes yeux, le mouvement de fond est ailleurs : une inflexion du cadre réglementaire après la grande période de resserrement post-2008. À l’époque, les régulateurs ont durci les contraintes en capital et en liquidité ; le secteur bancaire a été pénalisé pendant des années. Aujourd’hui, on perçoit une dynamique différente : les États-Unis ont indiqué qu’ils n’appliqueraient pas Bâle III tel quel, le Royaume-Uni a demandé des dérogations/extensions, et il n’est pas impossible que l’Europe évolue dans le même sens. Si cette dérégulation relative se poursuit, la perception de risque pourrait changer durablement, indépendamment du point du cycle. Pour le dire autrement : il y a un régime de sentiment et de régulation qui peut s’améliorer, en plus de la mécanique de courbe.
Revenir aux fondamentaux de la boussole : pourquoi la courbe des taux dicte tant la rotation sectorielle
Vincent Bezault : Pour boucler la boucle, rappelons le mécanisme. Pourquoi la courbe des taux — ses pentifications et ses aplatissements — pèse-t-elle autant sur les secteurs ?
Laurent Lamagnère : Parce qu’elle condense les anticipations de croissance et d’inflation, et qu’elle modifie le prix de l’argent selon les échéances. Une pentification baissière (les taux longs montent) récompense les modèles qui prêtent à long et s’approvisionnent à court — les banques — et soutient la prime des cycliques qui captent la reprise. Un aplatissement baissier (taux courts qui montent vite) pénalise les leviers élevés et exige des bilans solides. Un aplatissement haussier (taux longs qui baissent) revalorise les dividendes et ramène les défensifs au premier plan. Une pentification haussière (les taux courts qui baissent) justifie parfois une réduction de la poche actions au profit de l’obligataire, tout en laissant une niche de débat sur les bancaires.
Cette mécanique n’est pas magique ; c’est un cadre. En pratique, les politiques publiques, la géographie des profits et le comportement anticipatif du marché font bouger les lignes. D’où l’importance de lier la boussole à une lecture micro — qualité des bilans, visibilité des flux, positionnement concurrentiel.
Mode d’emploi : de la théorie à l’exécution
Vincent Bezault : Si l’on se place du point de vue d’un investisseur, comment utiliser concrètement cette boussole ?
Laurent Lamagnère : D’abord, identifier la phase probable, en acceptant une marge d’erreur. Ensuite, pondérer la lecture par ce que dit le marché : si le scénario est évident et déjà intégré, il faut moduler. Puis, calibrer secteur par secteur : cycliques en rebond, technologies et services quand les investissements repartent en expansion, défensifs en fin de cycle, exposition réduite en récession si l’allocation le permet. Enfin, ajouter les spécificités : plans de relance, régulation, contraintes commerciales, géographie des flux.
Rien n’est mécanique. La discipline consiste à lier la macroéconomie et la microéconomie, et à réviser la pondération au fur et à mesure que la courbe et la donnée évoluent.
Les faux amis du cycle : durées variables, signaux ambigus, zones désynchronisées
Vincent Bezault : Vous avez évoqué les pièges : durées de phases inégales, zones qui déphasent, marché qui prend de l’avance. Comment éviter les contre-temps ?
Laurent Lamagnère : On ne les évite pas toujours, on les gère. Les phases peuvent s’étirer ou raccourcir. Une récession anticipée peut tarder, une reprise peut surprendre. La datation se révèle souvent ex post. Les zones — États-Unis, Europe, Asie — se décalent. Une entreprise multi-exposée mixe des signaux. Et le marché sur-anticipe parfois : on a raison sur la macro, mais on arrive après. La solution : tenir une grille, observer la courbe, tester la sensibilité des portefeuilles et accepter une gestion dynamique des poids plutôt qu’un switch binaire.
Retour au présent : pourquoi la discipline de valorisation compte autant en fin de cycle
Vincent Bezault : Vous avez mentionné le price-to-book comme thermomètre. Pourquoi ce choix ?
Laurent Lamagnère : Parce que c’est un ratio relativement stable dans le temps, moins volatil qu’un cours/bénéfice soumis aux révisions de profits ou qu’un VE/EBITDA sensible aux hypothèses. En comparant la valorisation actuelle à la moyenne de long terme (par exemple 2006-2024) et en regardant si l’on est au-dessus de +1 écart-type, on situe le niveau de cherté. Or, après un fort rebond, beaucoup de segments se trouvent au-dessus de la moyenne. C’est un signal pour resserrer la sélection, pour surpondérer ce qui paie des dividendes visibles et alléger ce qui dépend trop d’une hypothétique prolongation de l’expansion.
Ce que la boussole ne dit pas… et que l’analyste doit apporter
Vincent Bezault : En définitive, que demande cette méthode à l’investisseur ?
Laurent Lamagnère : De la rigueur pour lier les signaux macro (courbe, croissance, inflation) et les réalités micro (bilan, cash-flows, dividendes, positionnement). De la souplesse pour adapter les pondérations sans dogme. Et de la vigilance face aux dérapages possibles : une phase qui raccourcit, un plan de relance qui rebattre les cartes, une régulation qui change l’équation d’un secteur — banques, santé — indépendamment du cycle. La boussole oriente ; l’exécution fait la différence.
Du rebond à la récession, les décisions d’allocation à prendre étape par étape
Vincent Bezault : Pour clore, reprenons vos filières décisionnelles phase par phase — sans inventer de règles, mais en conservant l’esprit de la boussole.
Laurent Lamagnère :
Rebond : réexposer les cycliques — biens industriels, consommation discrétionnaire, finance —, mettre en avant les banques favorisées par la courbe et un coût du risque sous contrôle, alléger les défensives à gros dividendes.
Expansion : poursuivre sur les cycliques et accélérer sur la technologie et les services, tout en surveillant l’endettement.
Fin de cycle : revenir vers les défensives — santé, consommation de base, distribution alimentaire, utilities, télécoms — et réduire les sensibilités à la croissance, avec des dividendes plus attractifs dans un contexte de taux longs en reflux.
Récession : limiter la poche actions si l’allocation le permet, renforcer les défensives, et débattre prudemment des bancaires entre pentification favorable et coût du risque plus élevé. C’est le cœur de l’outil ; pour le reste, on pondère avec le réel — plan de relance allemand, data centers et IA pour certains équipementiers, cadre commercial US-UE et CAPEX pour la santé, Bâle III et régulation pour les banques.
Et maintenant ? Entre discipline et nuance
Vincent Bezault : Si j’ai bien compris, la boussole donne un cadre, mais il faut garder un œil sur la réalité du terrain, là où apparaissent les nuances et les exceptions.
Laurent Lamagnère : Exactement. La boussole n’est pas l’alpha et l’oméga de la rotation sectorielle. Elle donne la direction. Mais il faut lire la réalité : valorisations (via le price-to-book), politique, régulation, géographie des profits, et anticipations déjà intégrées par le marché. C’est à ce niveau que l’analyse et la connaissance des entreprises prennent le relais, pour ajuster au plus fin ce que dit la macro.
Banques : pourquoi le changement de perception peut durer au-delà du cycle
Vincent Bezault : Revenons une dernière fois sur les banques, parce que c’est là que vous suggérez un régime de longue portée, au-delà de la simple courbe.
Laurent Lamagnère : Je le crois, oui. Entre un coût du risque maîtrisé — malgré quelques remontées ici ou là —, un environnement de taux encore favorable aux marges, et surtout un changement dans la régulation — États-Unis plus laxistes sur Bâle III, Royaume-Uni en demande de dérogations, Europe potentiellement alignée —, la perception pourrait évoluer durablement. Ce n’est pas seulement une histoire de cycle ; c’est une réécriture du cadre de risques qui pèse sur les multiples et ré-ancre le sentiment. C’est pourquoi, même si la récession nourrit le débat, je pense qu’il reste de la place pour que le secteur rattrape une partie du chemin perdu depuis 2008.
Retrouvez l’intégralité de cet entretien en cliquant sur la vidéo ci-dessus